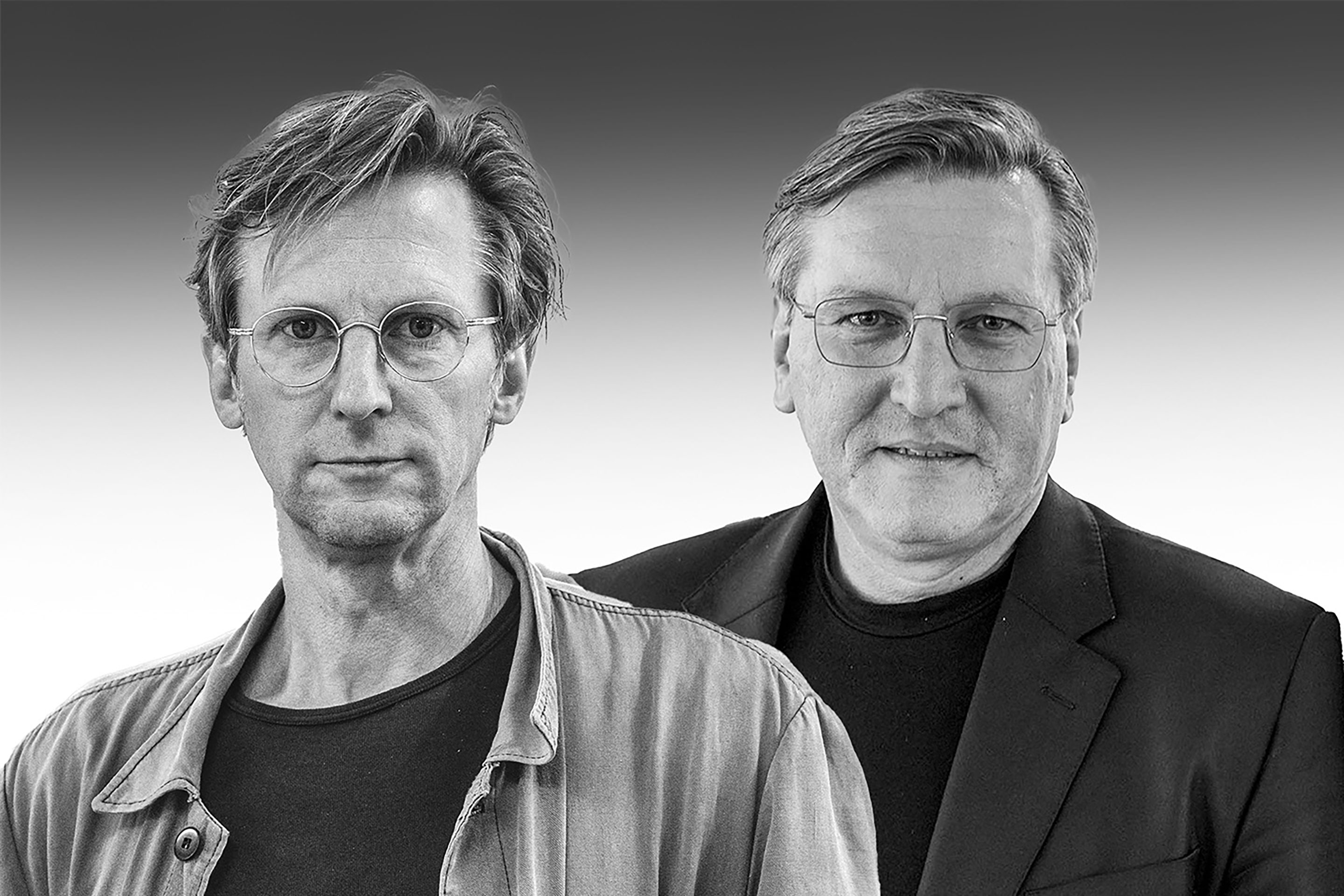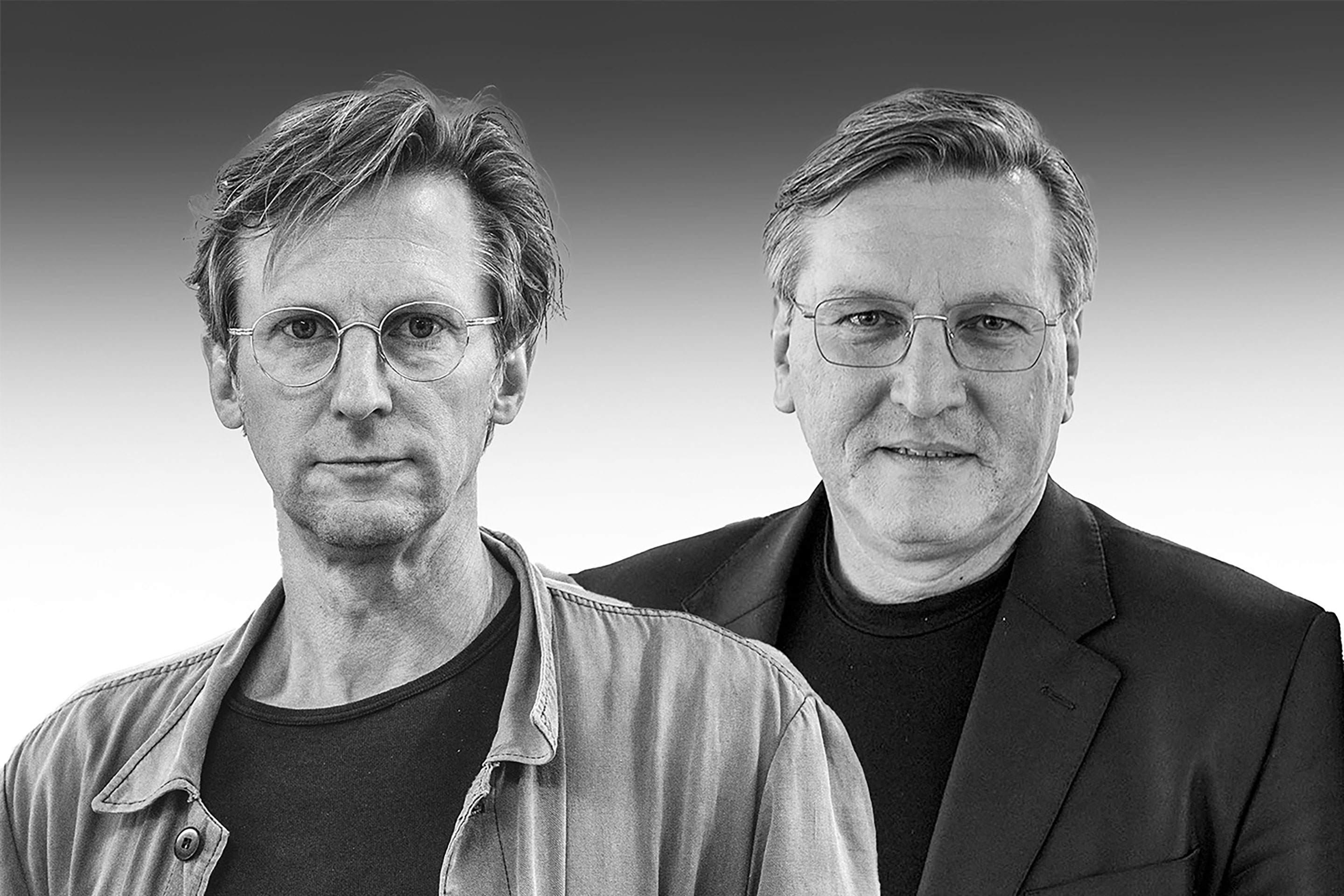
Le Prix Master Architecture de la SIA sera décerné pour la troisième fois cet automne. Cette distinction organisée à l’initiative de la SIA et du Conseil suisse de l’architecture offre un panorama unique de la filière Architecture en Suisse. Entretien avec deux membres du Conseil de l’architecture – Beat Waeber (ZHAW) et Christoph Gantenbein (ETH Zurich) – à propos de cette nouvelle coopération entre universités et hautes écoles spécialisées.
Depuis sa réédition en 2022, le Prix Master Architecture de la SIA intègre désormais les neuf hautes écoles suisses qui proposent un master en architecture. Cette formule a-t-elle d’ores et déjà fait ses preuves?
Beat Waeber: Du point de vue de la ZHAW, l’intégration des hautes écoles spécialisées est un franc succès. Le Prix Master Architecture de la SIA illustre l’ambition que nous nourrissons pour la formation de master, dont nous sommes heureux de présenter les résultats dans le cadre d’une saine concurrence. Les projets primés ces deux dernières années, présentés dans le cadre de l’exposition «Sign of the Times» au Musée suisse d’architecture S AM de Bâle, témoignent des enjeux, des questionnements et des approches qui préoccupent les étudiant·es.
Christoph Gantenbein: Beat Waeber et moi-même, nous vous parlons à la fois en tant que représentants de nos écoles et comme membres du Conseil de l’architecture. Du point de vue du Conseil de l’architecture, le Prix Master est un immense succès. Le fait qu’il en soit à sa troisième édition sous cette forme et qu’il fédère les hautes écoles est le signe que le Conseil de l’architecture fonctionne en tant qu’institution et qu’il s’est établi comme une association active. C’est loin d’être négligeable dans la période incertaine que nous traversons. Chaque opportunité de mise en réseau et d’échange constitue un facteur de stabilité. Il apparaît essentiel de faire vivre ce type d’échange dans le domaine de l’architecture également.
Le Conseil de l’architecture a-t-il un vœu à formuler concernant le Prix Master? Une distinction au niveau du bachelor?
Beat Waeber: Le Prix Master de la SIA est un pilier majeur dans la discussion sur la qualité de l’enseignement architectural. Permettez-moi une petite digression à ce sujet: le Conseil de l’architecture a été créé en 2008 comme plateforme de discussion entre les universités et les hautes écoles spécialisées (HES). Son but était d’harmoniser l’enseignement de l’architecture en Suisse dans le cadre de la réforme de Bologne et de définir les profils de compétences des programmes de bachelor et de master. Sur la base du système dual de formation, il s’agissait de coordonner la formation de bachelor, mais aussi celle de master, entre les hautes écoles. Aujourd’hui, les universités et les HES offrent des cursus aux deux niveaux. De même, l’ancienne ligne de démarcation qui divisait la recherche – aux HES la recherche appliquée, aux universités la recherche fondamentale – est révolue. Conformément à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) en vigueur depuis 2015, la Confédération et les cantons se partagent la responsabilité des HES. Cela donne naissance à des concepts de formation différents du point de vue de la didactique et des contenus. Il paraît donc d’autant plus important que le Conseil de l’architecture encourage et soutienne le débat sur l’enseignement de l’architecture. La mise en concurrence, comme c’est le cas avec le Prix Master de la SIA, est un outil adéquat. On peut bien sûr discuter de l’opportunité de créer un Prix Bachelor de la SIA. Cela dit, les profils de compétences et les programmes d’études des HES sont encore trop différents pour que l’on puisse comparer les activités et les projets d’étude.
Christoph Gantenbein: En la matière, l’ETH Zurich a une position différente de celle des hautes écoles spécialisées. L’étudiant·e type à l’ETH se lance directement dans les études une fois la maturité en poche. Après seulement trois ans, il est encore trop tôt pour espérer une expression architecturale individuelle. Les choses sont différentes dans les hautes écoles spécialisées, où l’on rencontre souvent de jeunes gens qui entament des études après avoir suivi une formation préalable dans le domaine de la construction. Le domaine de l’architecture est de plus en plus complexe. C’est pourquoi je ne suis pas vraiment favorable à une formation qui se limiterait au niveau bachelor. À titre personnel – et je pense pouvoir parler au nom de l’ETH – je ne souhaite pas que l’obtention de ce diplôme soit consacrée par un prix dédié. J’encouragerais plutôt les jeunes gens à acquérir une expérience professionnelle après leur formation de bachelor, puis à reprendre directement un master. Dans notre métier, cette capacité à porter un regard critique et indépendant est d’une importance cruciale. Et de mon point de vue, on ne l’acquiert pas avant le niveau master.
Beat Waeber: C’est un avis que nous partageons à la ZHAW. Le diplôme de bachelor obtenu après six semestres y est considéré comme une première qualification professionnelle. Dans les hautes écoles spécialisées aussi, un cursus d’architecture complet comprend dix semestres, master inclus.
À observer les travaux présentés, on est frappé de voir qu’ils s’affranchissent des limites d’une «architecture de l’objet», où l’architecte se place en signataire d’une œuvre. Cela transparaît non seulement à travers les thèmes abordés, mais aussi les modalités de représentation. S’agit-il d’une tendance générale dans les écoles ou cela tient-il au fait que les écoles ne soumettent que ce type de travaux?
Beat Waeber: Je pense que ces travaux reflètent la culture du bâti telle qu’elle est actuellement enseignée et plébiscitée par le corps étudiant. L’enseignement de l’architecture s’est transformé. Au sein du Conseil de l’architecture, nous avons eu des échanges très intenses au sujet du métier d’architecte. En tant que plateforme regroupant les établissements de formation, nous devons non seulement repenser la pratique professionnelle actuelle, mais aussi présenter un programme des compétences que nous allons enseigner dans les cinq à dix prochaines années. Les travaux des étudiant·es montrent bien à quel point les questionnements en matière d’architecture ont évolué.
Cette approche permet-elle de préparer les étudiant·es à l’exercice du métier ou crée-t-elle un fossé entre la formation et le terrain?
Beat Waeber: Compte tenu du changement climatique et de l’empreinte carbone considérable du secteur de la construction, je dirais que le terrain est encore trop timoré. La question de la construction durable devrait figurer en tête des priorités dans les écoles d’architecture et être enseignée à la mesure des enjeux. En la matière, le terrain devrait suivre l’enseignement et non l’inverse. Cela me fait penser à un aphorisme de Luigi Snozzi qui date du milieu des années soixante-dix: «Le jour où les diplômés d’une École d’Architecture ne pourront plus servir dans les bureaux, l’École aura fait un grand pas en avant.» Cette citation reste entièrement d’actualité. Nous ne pouvons pas nous contenter de former nos étudiant·es à la pratique actuelle, nous devons leur permettre d’élargir leur réflexion à des champs plus vastes. Dans notre école, par exemple, les travaux de master sont étroitement liés aux projets de recherche de l’école, ce qui implique des interactions entre l’enseignement et la recherche. De plus, tous les projets de mémoire de master sont des travaux individuels dont le sujet est choisi par les étudiant·es. Les questionnements sont donc à l’image des sujets traités dans notre école en lien avec la recherche.
Christoph Gantenbein: Il existe évidemment une multitude de pratiques. Le métier s’est diversifié et l’acte de construire n’est aujourd’hui qu’une option parmi d’autres. Aussi est-il important que l’enseignement reflète cette diversité. Un architecte est un généraliste. L’enseignement transmet une méthodologie qui permet de répondre à des questions complexes. Ce n’était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans. À l’époque, les questions étaient prédéfinies et le résultat pouvait, d’une certaine manière, être anticipé. Mais notre monde est devenu tellement complexe que même pour des projets de construction classiques, je passe d’ores et déjà plus de la moitié de mon temps à travailler non pas sur le projet, mais sur les à-côtés. Nous ne sommes pas de simples exécutants. Les questions de procédure ont pris une place prépondérante. L’architecte doit être capable de faire le tri au sein d’une situation complexe et de prendre position. En ce sens, je pense qu’il est essentiel pour la pratique que les étudiant·es procèdent à un examen critique de leur mission et se posent les bonnes questions. Et en même temps, nous avons besoin d’un savoir-faire en matière de construction, qui se trouve quelque peu mis à mal dans cette approche. Il reste à savoir dans quelles conditions les étudiant·es, qui finiront tôt ou tard par travailler sur des projets dans un bureau, peuvent accéder à ces connaissances.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez suggérer pour l’organisation future du Prix Master de la SIA?
Christoph Gantenbein: J’ai été impressionné par le niveau des travaux de master exposés au S AM. Et le fait de ne pas toujours savoir d’où venaient les travaux n’est pas pour me déplaire. Je suis très heureux que cette exposition existe et que l’évolution du métier puisse ainsi être portée à la connaissance du public. L’exposition a joué un rôle pédagogique important de ce point de vue.
Beat Waeber: Je trouverais souhaitable que ce format soit institutionnalisé. L’exposition témoigne d’un niveau en architecture élevé dans tous les établissements d’enseignement supérieur, que ce soit dans les HES ou les universités. On ne pouvait pas le savoir avant 2022, puisque seules les universités étaient admises au prix. L’instauration d’une exposition régulière permettrait d’entretenir une culture du débat sur l’enseignement de l’architecture en Suisse.
Christoph Gantenbein: Le montage de cette exposition a été le fruit d’un heureux hasard. Je tiens d’ailleurs à remercier, au nom du Conseil de l’architecture, toutes les écoles qui ont soutenu le projet sans réserve et si rapidement. En institutionnalisant le format, on risquerait de perdre ce caractère de projet. Cela dit, nous devons avoir l’ambition de porter notre réflexion dans l’espace public! Peut-être verra-t-on les travaux primés exposés dans le pavillon suisse de la Biennale d’architecture ou dans un autre cadre international ? Ce qui compte, c’est de pouvoir mobiliser l’énergie et l’attention d’un large public en faveur du prix. C’est un point qui me paraît plus important que la régularité de l’événement.